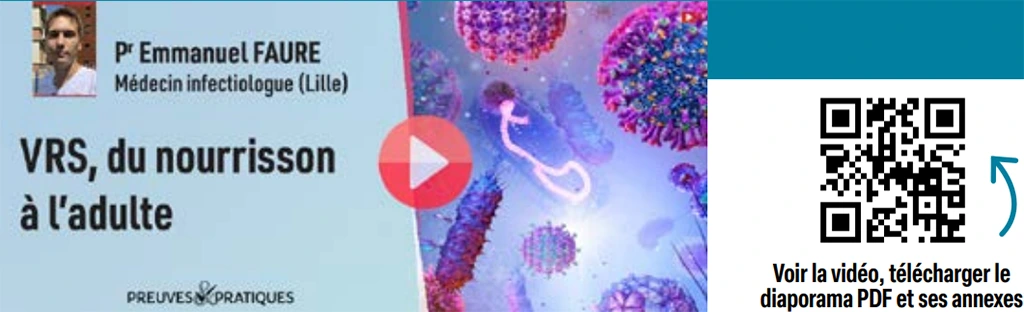Jusqu’à 2 % des enfants de moins de 12 mois étaient hospitalisés pour une infection à VRS, 90 % d’entre eux n’ayant pourtant aucun FDR. Ce risque est maximum avant 2 mois. Depuis 2024, une protection de tous les nourrissons est possible grâce à une simple injection d’Ac monoclonal avant la sortie de la maternité. Une alternative est maintenant possible, par vaccination maternelle lors du 8e mois de la grossesse. Ces 2 stratégies sont en réalité complémentaires et peuvent être discutées selon la période de naissance.
Chaque année, le VRS entraînerait plus de 25 000 hospitalisations et près de 2000 décès chez les plus de 60 ans, sans compter le recours ambulatoire au système de santé. Ce risque augmente avec l’âge et les comorbidités, notamment respiratoire et cardiovasculaire, mais aussi diabète et maladie rénale chronique. Après 50 ans, les infections à VRS sont associées à la survenue d’événements CV : 25 % des patients
présentent un événement de type insuffisance cardiaque aiguë, syndrome coronarien aigu ou tachycardie ventriculaire.
Ces impacts restent particulièrement sous-estimés, surtout par méconnaissance. La proportion d’adultes hospitalisés pour infection respiratoire virale est équivalente pour VRS et grippe, et les risques de transfert en soins critiques et de mortalité liés au VRS sont supérieurs à ceux de la grippe. Les 2 vaccins disponibles montrent une efficacité vaccinale équivalente :
- > 80 % la première année, qui est donc supérieure à celle du vaccin anti-grippe,
- La revaccination après 1 an ne semble pas augmenter l’efficacité vaccinale, du moins pour l’instant (la protection persiste à 3 ans).
Si la protection des nourrissons semble d’ores et déjà un réflexe quasi acquis (choix de la stratégie mis à part), la stratégie de vaccination des personnes âgées reste à mieux préciser :
la vaccination des > 75 ans et des > 65 ans avec comorbidité est souhaitable, mais pas encore de recommandation officielle et donc pas de remboursement ! Une coadministration avec le vaccin grippal pourrait être pertinente et permettre un moindre recours au système de santé, l’hiver en particulier.